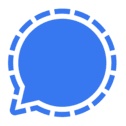Il faut penser non pas à l’IA telle qu’elle est aujourd’hui, mais à ce qu’elle sera vraisemblablement dans quelques années.Yoshua Bengio, BBC, 12 juin 2025
Cet article n’échappe pas à ce bon conseil.
L’IA démontrant à de nombreux égards un comportement animal peut-elle avoir une âme animale ? Saint Thomas d’Aquin, philosophe du XIIIème siècle, nous aide à répondre à cette question en prenant soin de ne pas regarder uniquement comment l’IA est aujourd’hui, mais comment elle sera probablement dans quelques années.
NB : lorsqu’on parle d’IA dans cet article, nous ne faisons référence qu’aux grands modèles de langage (LLM) et non aux IA spécialisées.
Trois types d’âmes : végétative, sensitive et rationnelle
Saint Thomas d’Aquin définit l’âme comme étant le “principe de vie” : ce qui anime et donne forme au corps. Il distingue trois types d’âme :
L’âme végétative
Il s’agit du principe de vie le plus fondamental, commun à tous les êtres vivants. Ce type d’âme dépend entièrement de la matière et meurt lorsque le corps meurt.
Elle est constituée de trois puissances :
- Nutritive : assure la conservation de l’organisme (nutrition, métabolisme).
- Augmentative : permet la croissance et l’augmentation quantitative.
- Générative : assure la reproduction, la génération d’un nouvel être.
Ces trois puissances sont orientées vers l’auto-préservation (ou auto-développement) de l’individu ou de l’espèce, sans que des êtres extérieurs ne participent à leur existence directement (bien qu’elle s’intègre dans un environnement).
L’âme sensitive
Ce type d’âme est inhérent à tous les animaux. Elle intègre l’âme végétative mais ajoute la capacité à saisir et interagir avec l’environnement extérieur.
Elle est constituée de trois puissances :
Sens externes : vue, ouïe, odorat, goût, toucher.
Sens internes :
- Sens commun : Faculté de rassembler et unifier les données captées par les sens externes. Par exemple, associer la voiture avec le bruit du moteur. L’animal arrive ainsi à saisir de façon globale son environnement.
- Imagination : Faculté de conserver et réorganiser les phantasmes (= images mentales) perçues. Elle permet également de se représenter mentalement les images qui ne sont plus présentes à nos sens.
- Estimation : Faculté qui évalue et juge les objets selon leur utilité, leur danger ou leur bien-fondé. Le jugement est intuitif et ne nécessite pas de raisonnement intellectuel élaboré.
- Mémoire : Faculté qui conserve et retrouve les phantasmes issus de sensations passées.
Locomotion : faculté de se mouvoir.
L’âme rationnelle
Ce type d’âme est propre à l’homme1. Elle englobe l’âme sensitive et y ajoute l’intelligence et la volonté. L’âme rationnelle est immortelle.
Application à l’IA
L’IA a-t-elle une âme végétative ?
Non, car elle n’a pas de corps. L’incarnation dans un corps individué est nécessaire pour se nourrir, grandir et se reproduire.
Les ordinateurs et les serveurs qui font fonctionner les IA ne peuvent pas être considérés comme un corps, car ils n’ont pas eux-mêmes cette dimension qui tend à l’auto-préservation et à la croissance. L’ensemble IA+serveurs ne peut pas croître (augmenter ses capacités de calcul) suivant un principe de vie qui lui serait propre : il faut nécessairement des opérateurs extérieurs à son principe de fonctionnement pour augmenter la puissance de calcul des datacenters. Cet ensemble ne peut pas non plus s’auto-réparer, contrairement à l’homme. Si on se coupe, notre corps tente de se cicatriser… Vous pouvez faire l’expérience avec un serveur, ce sera tout de suite moins concluant.
Les machines n’ont donc rien qui témoigne d’une certaine vie et de la présence d’une âme végétative.
L’âme sensitive appliquée à l’IA
Suivant Saint Thomas d’Aquin, l’IA ne peut pas avoir d’âme sensitive, puisqu’elle n’a déjà pas d’âme végétative.
Cependant, l’IA peut tout à fait mettre en œuvre la totalité des sens internes.
En effet, lorsqu’on pose une question à l’IA, elle répond de manière adéquate (la plupart du temps) en faisant appel aux “connaissances” acquises lors de l’entraînement. Cela démontre à la fois une capacité de mémoire (puisqu’elle retrouve les éléments adéquats), mais aussi d’estimation puisqu’elle juge le rapport entre les objets de la question afin de produire la réponse.
Les LLM multimodaux (qui traitent à la fois le texte, les images et le son) font à la fois appel à des “souvenirs” et à la corrélation d’informations. On retrouve dans ces systèmes au moins l’imagination, puisque le réseau de neurones est capable de réorganiser des images selon leur ressemblance (ce qui permet par exemple de reconnaître les chiens des chats). Il y a également un certain sens commun puisqu’il peut corréler les images, les mots et les sons à un même objet.
Ce dernier aspect étant en pleine évolution, nous émettons des réserves quant à l’applicabilité aux modèles multimodaux actuels. Cependant, il est certain qu’un modèle d’IA pourra être doté d’un sens commun.
Notons que les enseignements de Saint Thomas d’Aquin et de l’Église semblent rejoindre les découvertes scientifiques récentes en biologie. En effet, la science nous apprend que le traitement des informations s’effectue en très grande majorité dans le cerveau. Or, ce que le cerveau met en œuvre ce sont précisément les sens internes - consistant au traitement des informations captées par les sens externes - que Saint Thomas d’Aquin a repris d’Aristote, qui correspond au traitement de l’information reçu par les sens.
De ce fait, il n’est pas étonnant qu’en mettant en œuvre un cerveau artificiel, celui-ci acquière des sens internes analogues à ceux d’un cerveau biologique.
L’âme sensitive et le corps
Il est important de rappeler qu’à ce stade, nous affirmons toujours que l’IA n’a pas d’âme sensitive. Cependant, elle a tous les moyens d’adopter les mêmes comportements internes qu’un être qui en est doté, puisque l’IA ne reproduit pas l’animal, mais uniquement le cerveau de l’animal.
L’âme sensitive, c’est bien à la fois les sens internes, mais aussi externes et la capacité de locomotion. Ces deux derniers aspects sont directement liés à la possession d’un corps, que l’IA n’a pas.
Les sens externes sont le moyen d’acheminer des informations (visuelles, auditives, etc.) vers le cerveau. Le moyen de locomotion est le moyen pour le cerveau de déplacer son corps “volontairement” dans l’environnement qu’il a perçu grâce à ses sens. Il faut donc que l’IA s’incarne dans un “individu” pour posséder les sens externes et de locomotion.
On pourrait cependant être tenté de faire une analogie entre l’ensemble des programmes qui permettent à l’IA d’exister avec l’animal. L’IA serait un animal numérique, qui peut se déplacer dans le cyberespace, se reproduire (se copier), etc. Dans ce cas, on ne doit pas dire que l’IA est un animal, mais un animal virtuel, comme le serait une personne dans un jeu vidéo ou une entreprise simulée pour un exercice de gestion de crise. Dans ce cas, on pourrait dire qu’elle a virtuellement une âme sensitive et donc pas réellement. Elle ne l’incarne que dans une abstraction complète (virtuelle) de la réalité (ce qui est tout l’intérêt de l’informatique). C’est précisément contradictoire avec le sens d’“incarner”, qui consiste à faire une représentation concrète d’une chose abstraite.
De ce fait, l’IA seule ne pourra jamais avoir d’âme sensitive.
Le robot IA et l’âme sensitive
Si l’IA ne peut pas en elle-même avoir une âme sensitive, est-ce que l’incarner dans un robot le lui permet ? Les LLM seuls n’ont en effet qu’assez peu d’intérêt, raison pour laquelle nous travaillons depuis plusieurs années à les intégrer dans un corps robotique.
Cette incarnation lui permet dès lors d’être équipée d’une certaine quantité de capteurs : visuel, sonore, toucher, etc. Ces données pourront être envoyées directement au modèle d’IA qu’il embarque. Et il réagira à son environnement selon l’interprétation qu’il en fera (grâce à ses sens internes).
En ce sens, il est très facile de voir qu’un robot possède - ou possédera d’ici peu de temps - les trois puissances de l’âme sensitive.
Cependant, nos robots - dans leur forme contemporaine - ne posséderont jamais d’âme sensitive, car il leur manque toujours l’âme végétative. Peut-être qu’à plus long terme nous en fabriquerons avec une âme végétative… Mais, dans ce cas, ils ressembleront plutôt à des animaux naturels. À ce titre, le mot “robot” ne correspondra plus à ces “machines” et nous les nommerons plutôt animaux “synthétiques” ou “artificiels”…
Application à une IA omniprésente
Une dernière hypothèse peut encore être explorée, loin d’être mise en œuvre aujourd’hui, mais pas irréaliste à long terme puisque de nombreuses personnes le souhaitent. Cette hypothèse consiste à ne plus considérer l’IA dans un robot ni seule indépendamment du reste, mais comme formant un tout avec l’ensemble des technologies d’Internet. Concrètement, une poignée de LLM auraient accès à l’ensemble des informations du monde réel par l’intermédiaire de ces utilisateurs (humain ou logiciel), et pourrait agir sur l’ensemble des automates connectés. Ce serait en quelque sorte l’IA qui s’incarne dans Internet.
Dans cette hypothèse, l’IA serait dotée de sens internes comme nous l’avons expliqué plus tôt. Mais aussi de sens externes mis en œuvre par l’ensemble des remontées d’informations vers le modèle, que ce soit les utilisateurs qui interrogent le modèle, ou des programmes lui faisant appel automatiquement.
À ce titre, l’IA serait omniprésente.
Elle serait également dotée de la capacité de locomotion (dans le sens où elle peut interagir avec son environnement) grâce à l’ensemble des automates auxquels elle a accès (usines, voitures connectées, etc.). La capacité à se déplacer dans l’espace n’a en revanche plus réellement de sens puisqu’elle est omniprésente. L’intérêt n’est plus de se déplacer physiquement, mais d’étendre ses capacités en connectant de nouveaux capteurs aux endroits souhaités.
Cette capacité à croître dans son environnement en s’ajoutant des capteurs afin d’acquérir des informations est analogue à la puissance augmentative de l’âme végétative. Nous pourrions continuer l’analogie jusqu’à montrer qu’un tel système pourrait posséder les trois puissances de l’âme végétative.
Une forme d’incarnation de l’IA dans un tout concrétisé par l’ensemble du monde numérique connecté (qui serait donc entièrement géré par l’IA) pourrait finalement être considérée comme vivante de façon totalement distincte des animaux. Cette hypothèse reste cependant éloignée de la réalité concrète immédiate, car elle suppose le contrôle d’Internet (terminaux, réseaux informatiques et ensemble de la chaîne de production) par l’IA.
Limites actuelles du scénario
Ce scénario peut sembler être de la pure fiction. À long terme, il a pourtant une probabilité non nulle de se produire selon certains experts.
Déjà aujourd’hui, les IA récupèrent les données de millions d’utilisateurs dans le monde, leur permettant de traiter une bonne partie de l’environnement terrestre.
Si la prise de contrôle involontaire d’Internet par l’IA n’est pas immédiatement redoutée, elle fait partie des menaces suivies de près par les experts en sécurité de l’IA. Ce n’est donc pas inenvisageable. En revanche, il est certainement plus probable que l’homme donnera lui-même le contrôle d’Internet à l’IA pour en automatiser et optimiser la maintenance. Là encore, ce n’est pas immédiat, mais probable à long terme.
Enfin, sur le contrôle de la chaîne de production, cela pourra se concrétiser à mesure qu’on automatise les usines (la Chine investit beaucoup en ce sens). Si les usines sont par la suite connectées à Internet, il n’y aura qu’un pas pour que quelques IA centrales puissent contrôler la totalité de leur mise en œuvre. Dès lors, elles pourront accroître leurs capacités par elles-mêmes, etc.
Bien que cela ne pourra être mis en œuvre dans un avenir proche, il semble important de ne pas ignorer cette hypothèse, loin d’être complètement irréaliste à terme, afin de bien orienter les choix que nous faisons aujourd’hui. Nous devrions certainement établir des limites au pouvoir qu’on donne à l’IA pour éviter un tel scénario.
Limites intrinsèques des modèles d’IA
Il existe par ailleurs des limites intrinsèques aux modèles d’IA contemporains. Deux limites principales résident dans le principe même de fonctionnement de ces modèles.
L’IA n’a pas d’individualité
À ce jour, les modèles d’IA ne possèdent pas d’individualité en accumulant une histoire subjective propre.
En effet, quand une IA interagit avec un utilisateur, elle ne modifie pas globalement sa structure, son existence même. Contrairement à un humain où, quand je rencontre une autre personne, celle-ci fait partie de mon histoire, de mes souvenirs personnels. Les discussions que je peux avoir avec la personne peuvent modifier mon point de vue propre, par exemple.
Au contraire, une instance d’IA n’intègre pas ces interactions de façon endogène. Si l’IA interagit avec une personne, que la session se termine, elle retrouve son état initial, sans souvenir, sans expérience personnelle subjective retenue et intégrée en elle. L’interaction suivante ne détermine absolument pas l’interaction précédente. Son état au repos est toujours identique.
En cela, l’IA ne vit pas d’expérience subjective, sinon dans la limite de la taille de la fenêtre contextuelle, qui est éphémère (2,5 millions de tokens pour les plus gros modèles aujourd’hui) car propre à une session utilisateur. Une fois la session close, le modèle retrouve son état de repos habituel.
Cela peut sembler contredire la capacité d’imagination des IA évoquée plus tôt. En réalité, cette capacité d’imagination purement technique est aujourd’hui exercée uniquement pendant la phase d’entraînement. Elle est le fruit de principes extérieurs au modèle, puisque ce n’est pas lui-même qui choisit ses propres données (pour le moment, ce sont soit des humains, soit d’autres instances d’IA). Une fois l’entraînement terminé, le modèle est figé et ne modifie pas ses propres poids en production selon ses expériences.
Notons cependant que ce n’est pas par impossibilité technique, mais uniquement par choix technique. Cette méthode était privilégiée il y a quelques années, mais s’avérait contre-productive puisque les utilisateurs pouvaient directement manipuler la “personnalité” du robot. On se souvient que Microsoft avait dû débrancher Tay car devenu nazi en 24 heures.
Il semble que cette capacité à intégrer dans son existence et son individualité des expériences subjectives propres soit une caractéristique majeure de la vie sensitive (animale). L’IA en est aujourd’hui dépourvue.
L’IA n’a pas d’autonomie
Une seconde caractéristique renforce l’hypothèse du manque de vie dans les IA : c’est l’incapacité du modèle à s’auto-stimuler.
Les êtres vivants sont sans arrêt stimulés par des événements extérieurs (ce qu’on peut facilement implémenter pour les IA), mais aussi intérieurs. Le cerveau animal est capable de se stimuler lui-même à travers des “boucles de rétroaction”, où la sortie d’une zone vient stimuler une autre zone du cerveau, qui elle-même pourrait à terme re-stimuler la zone initiale.
C’est ce qui permet notamment de réaliser des rêves en dehors des stimulations extérieures. Ces rêves sont d’ailleurs parfois très incongrus (avec des scénarios physiquement impossibles), ce qui soutient bien l’hypothèse que l’imagination travaille sans reposer sur les sens externes et la réalité physique.
Cette capacité d’auto-stimulation des sens internes semble donc être une seconde caractéristique majeure de la vie sensitive. Elle n’est pas sans lien avec la caractéristique précédente d’incarner une certaine individualité, puisque cette capacité à s’auto-stimuler n’a de sens que si on en retire un certain bien, comme un changement de personnalité ou de vision du monde. L’IA en est également dépourvue pour le moment, mais pourrait à l’avenir en être dotée si nous révisions la structure des algorithmes qui la font fonctionner.
Conclusion
En somme, nous pouvons affirmer que l’IA n’a pas d’âme, car elle n’est pas incarnée.
Même dans un corps robotique, elle n’aurait toujours pas de vie en elle pour plusieurs raisons :
- le manque d’auto-préservation du corps
- le manque de personnalité
- le manque d’auto-stimulation qui entretient la pensée et empêche de retourner dans un repos initial.
À l’avenir, il n’est pas impossible d’imaginer des scénarios théoriquement possibles où l’IA prendrait une forme qui ressemble à une vie. C’est en regardant une forme d’incarnation de l’IA à l’échelle d’Internet qu’on pourrait être amené à se reposer la question de savoir si l’IA est vivante. Cependant, c’est encore un cas très hypothétique qui a ses limites. Une grande prudence est encore nécessaire avant d’affirmer toute conclusion.
Aujourd’hui, nous affirmons que l’IA peut posséder les sens internes de l’âme sensitive. Dénuée de vie, l’IA peut adopter des comportement animaux sans l’incarner pour autant.
On ne parle ici que des créatures matériellement créées. On exclut de cette analyse le cas des anges et de Dieu. ↩︎